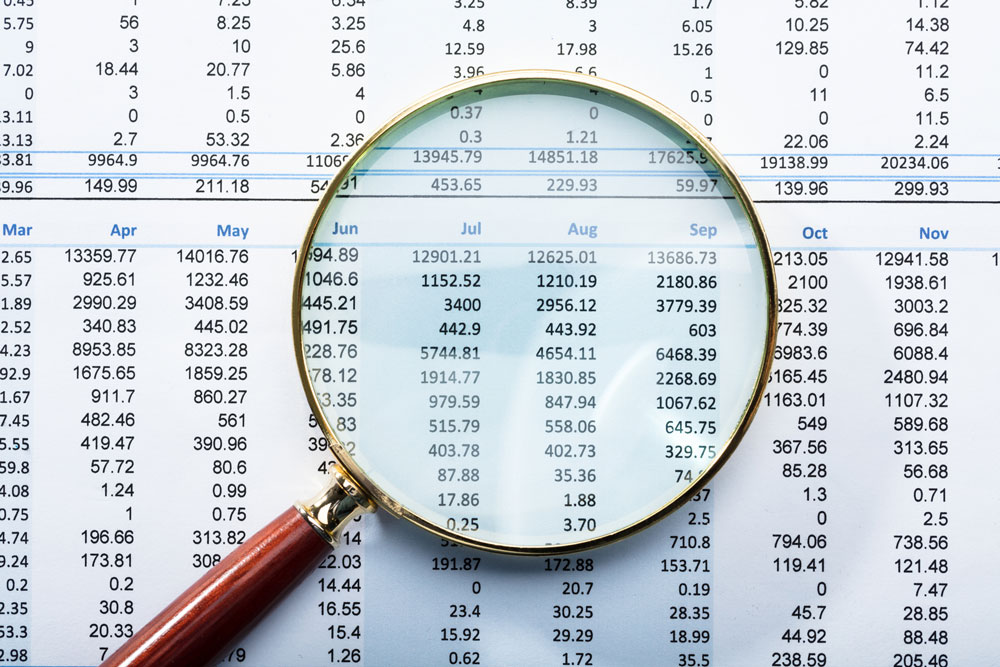C’est un véritable raz-de-marée. Une sorte de « sauve-qui-peut » s’empare des investisseurs et provoque un tsunami dévastateur sur une partie de la cote. Les pertes sont lourdes, si l’on se fie aux performances (hors dividendes) sur un an glissant de plusieurs titres sinistrés : WPP -62 %, Dassault Systèmes -56 %, SAP -38 %, Capgemini -35 % et Publicis Groupe -24 %.
Pourtant, ces chutes n’ont rien à voir avec la réalité. Car ces sociétés ont connu une stabilité ou une progression de leur bénéfice par action depuis un an. Sauf pour Capgemini dont la baisse est restée contenue (-3,66 %). Nous assistons donc à une forte compression des multiples de valorisation.
Quelle est l’explication cohérente d’un tel désengagement ? Faut-il acheter ou vendre ces valeurs actuellement totalement délaissées ?
Au secours, c’est l’intelligence artificielle
Depuis le lancement réussi de ChatGPT en novembre 2022 et du milliard estimé d’utilisateurs dans le monde de tous les différents modèles de langage large existants (LLM), la perception de cette révolution technologique était positive. Avec de superbes performances boursières pour de nombreux acteurs, dont Nvidia (+1 287 % hors dividendes réinvestis depuis le 01/11/2022).
Utilisation progressive des outils d’IA et investissements colossaux
L’utilisation progressive des outils (dont le spectre est très large) contenant de l’IA était également synonyme d’investissements colossaux, voués à croître encore substantiellement ces prochaines années. L’IA n’étant plus abstraite, mais une réalité, voilà que désormais les investisseurs se penchent sur ses conséquences concrètes sur l’ensemble des secteurs. Le gain évident pour de nombreuses entreprises est une forte automatisation de nombreuses tâches dans plusieurs fonctions. Et ce, à différents niveaux hiérarchiques, et donc un bond de productivité. Dorénavant, cette révolution technologique est également associée à une forte hausse des licenciements et du chômage pour une partie de la population active. Celui des jeunes a atteint un pic récent de 10,60 % en novembre dernier aux États-Unis, et 21,5 % en France au 4ème trimestre 2025, selon l’INSEE. Voilà que l’IA crée un choc générationnel !
Les perdants et les gagnants de l’IA
Les perdants identifiés sont cloués au pilori. Parmi ces pestiférés figurent, entre autres, les sociétés de logiciels (nos malheureuses SAP, Dassault Systèmes et Capgemini) et toutes celles proposant des services à fort capital humain dédiés aux entreprises. Des postes d’interprètes, de rédacteurs de comptes rendus, de publicitaires et même de programmeurs vont être remplacés par des solutions intégrant de l’IA. Les acteurs concernés devraient réaliser de forts gains de productivité et donc augmenter en théorie leurs marges. Seulement voilà, les opérateurs s’inquiètent de la survie de leur modèle économique et du futur niveau facturé au client. Face à cette inconnue, un seul réflexe : vendre d’abord et réfléchir ensuite.
Et maintenant, que vais-je faire ?
Faut-il acheter les gagnants ou les perdants de l’IA ? Cette question peut paraître stupide à première vue, car la réponse évidente et unanime devrait être d’acheter les gagnants et de vendre les perdants. Seulement, le marché a-t-il bien identifié et analysé correctement toutes les conséquences encore floues de cette révolution technologique ? Les exemples sont nombreux dans le passé, où ce ne fut pas le cas. L’évènement de DeepSeek, l’année dernière, a démontré que les investisseurs avaient vendu à tort les titres de la technologie américaine, s’alarmant de la concurrence chinoise, quelques semaines avant que Jensen Huang, CEO et fondateur de Nvidia, n’expliquait qu’au contraire, la multiplication des LLM allait augmenter les besoins d’infrastructures.
Tout mouvement de ventes massives et sans discernement crée donc des opportunités d’investissement. Un gérant n’est pas un mouton de Panurge et doit faire ses analyses au cas par cas. Dans l’exemple de la publicité, nous favorisons Publicis Groupe par rapport à WPP, parce qu’ils sont des éditeurs de logiciels pour la création publicitaire qui intègrent de l’IA. À l’inverse, dans chaque estimation, tous les paramètres doivent être pris en compte y compris de possibles coûts de restructuration qui peuvent plomber le résultat net. Vous l’aurez compris, vive la gestion active !
Les chiffres de la semaine
– -56 %. La performance du titre Dassault Systèmes depuis 1 an.
– 35. Le nombre consécutif de jours de pluie en France depuis le 14 janvier, un record depuis 1959.
– 3 milliards d’euros. Le coût maximal estimé des inondations en France en février 2026.