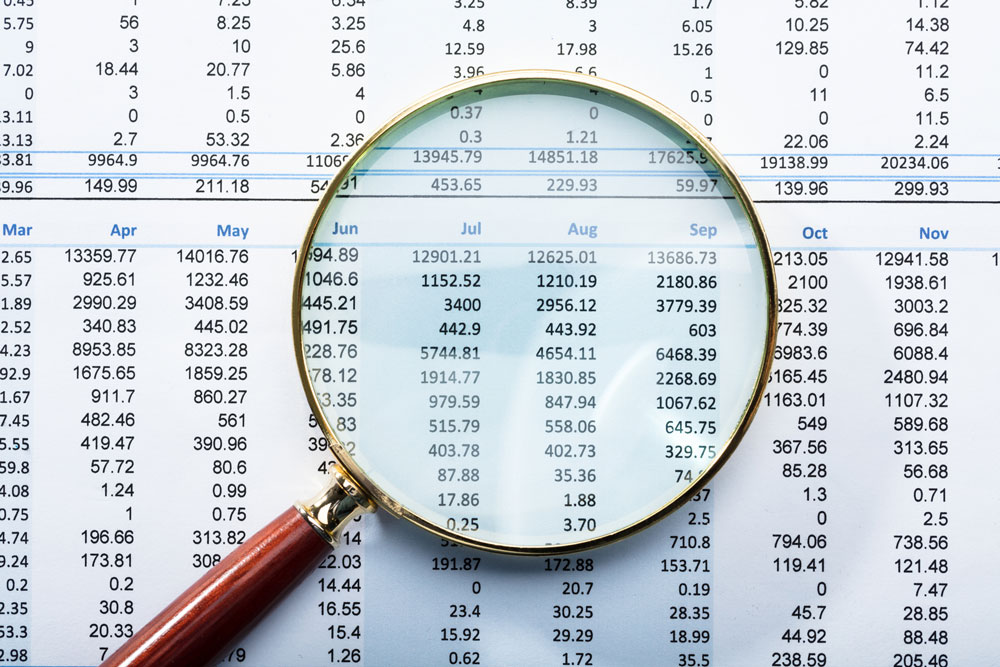Plus de 140 milliards de dollars de demande cumulée pour 30 milliards de dollars d’émissions obligataires réalisées en trois devises. Tel est l’immense succès de cette gigantesque levée de fonds réalisée cette semaine par Alphabet, propriétaire du moteur de recherche Google et du grand modèle de langage Gemini. Cet engouement est d’autant plus impressionnant qu’il intervient dans un marché redoutant fortement un excès d’investissement et d’endettement lié à l’intelligence artificielle.
Comment expliquer un tel engouement pour Alphabet ?
Il faut dire que les chiffres sont astronomiques. Et les compteurs s’affolent : plus de 650 milliards de dollars de dépenses cette année rien que pour les hyperscalers (entreprises utilisant de gigantesques infrastructures digitales). Ces besoins de financement, qui pourraient mondialement dépasser 2 000 milliards de dollars au cours de ces prochains exercices, effraient.
La réaction boursière sur le titre Amazon à l’annonce du 5 février relative à 200 milliards de CapExpour 2026 en est bien la preuve. Alphabet fait donc figure d’exception et les créanciers se sont littéralement battus pour lui prêter de l’argent. Comment expliquer un tel engouement ? Pourquoi la firme californienne apparaît-elle comme un des grands gagnants de cette révolution de l’intelligence artificielle ?
Un acteur unique dans cette course technologique
Vous connaissez sans doute les puces de Nvidia mais Alphabet dispose d’une arme secrète : les TPU (Tensor ProcessingUnits). Contrairement aux GPU de Nvidia, conçus pour être polyvalents, les TPU sont « taillés sur mesure ». Et exclusivement pour le calcul neuronal (utilisant des modèles mathématiques).
Cette spécialisation permet une efficacité énergétique et un rapport performance-prix bien supérieurs pour l’IA. Le dernier modèle conçu et commercialisé par Alphabet, Ironwood (TPU v7), rivalise désormais avec les puces Blackwell de Nvidia. Tout en offrant des coûts d’exploitation plus bas.
Alphabet : une infrastructure unique
Mais la véritable force d’Alphabet réside dans son infrastructure unique. Là où Nvidia se heurte aux limites physiques des câbles en cuivre, Alphabet utilise une technologie de pointe : la fibre optique couplée à des commutateurs optiques (OCS). Cela lui permet de relier plus de 9 200 puces en un seul maillage massif, fluide et ultra-efficace. C’est grâce à cette architecture hors norme que le groupe a pu entraîner entièrement son modèle Gemini 3, aujourd’hui considéré comme le meilleur modèle multimodal du marché.
Un beau rating AA et des coûts de financement bas
Oracle a connu une augmentation du coût de financement. Avec un spread de crédit (écart de taux avec celui de la dette de l’État) ayant doublé depuis fin septembre à plus de 200 points de base (2 %) pour des maturités de 30 ans. Alphabet, quant à elle, a vu son spread baisser depuis la publication de ses résultats du 23 janvier. Et ce malgré cette méga émission de dettes. La demande étant largement supérieure à l’offre, les spreads des 17 émissions proposées en dollar, en livre sterling et en franc suisse ont été réduits sensiblement par rapport à la proposition initiale. Encore plus incroyable, celui-ci a baissé depuis la précédente levée de fonds de fin novembre. L’entreprise s’est endettée pour plus de 55 milliards de dollars au total et les investisseurs en redemandent.
Microsoft est le prochain test avec son rating AAA
La firme de Redmond est la seule aux États-Unis, avec Johnson & Johnson, à bénéficier de la meilleure note de crédit : le AAA. Celle-ci n’a pas émis depuis juin 2024. Microsoft devrait se présenter au marché à partir de juin 2026. Il sera intéressant de voir si l’enthousiasme est au rendez-vous ou si les craintes sur la pertinence du modèle d’OpenAI (dont Microsoft est actionnaire) vont l’emporter.
Alphabet, une entreprise maître de son destin
Loin de l’euphorie, le géant de Mountain View construit une forteresse intégrée. En maîtrisant toute la chaîne, de la puce aux services comme la recherche ou les taxis autonomes Waymo, le groupe transforme ses dépenses en actifs durables. Ces investissements massifs ne sont pas une fuite en avant, mais les fondations d’une domination future. Le meilleur est, sans aucun doute, encore à venir. Pas étonnant que les créanciers aient souscrit de la dette à 100 ans sans savoir si le moteur de recherche Google existera toujours en 2126 !
Les chiffres de la semaine
– 140 milliards de dollars. La demande cumulée pour toutes les émissions de dette d’Alphabet.
– 6,125 %. Le taux de rendement en GBP de l’obligation à 100 ans émise par Alphabet.
– 68 564. Le nombre de défaillances d’entreprises en 2025, un record selon la Banque de France.